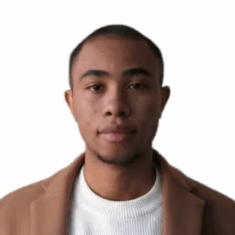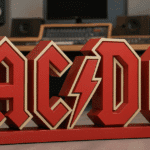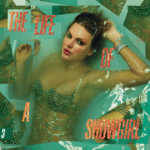Immersion dans la série Tales – format dédié aux artisans du son
Dans la musique, on a souvent tendance à mettre en lumière la finalité. Les visages, les voix, les scènes éclairées par des projecteurs trop chauds. Et cela au détriment du processus. On oublierait presque que derrière chaque riff qui reste en tête, chaque beat qui tourne en boucle, il existe une constellation d’artisans. Des gens qui sculptent le son, qui prennent les décisions invisibles, qui bossent tard, qui doutent parfois, mais qui avancent parce qu’ils savent qu’un détail peut tout changer.
C’est pour eux qu’on a imaginé Tales.
Un format qui plébiscite celles et ceux qui font la musique : les ingénieurs du son qui sauvent une prise au dernier moment, les manageurs qui repèrent une étincelle avant tout le monde, les directeurs artistiques qui donnent un cap quand un projet cherche encore sa forme, les techniciens qui montent une scène en un temps record, les musiciens qui accompagnent, qui rassurent, qui subliment.
Simon Clair – en quelques projets
Pour ce premier épisode, on a tendu le micro à Simon Clair, journaliste musical, auteur, documentariste. Ancien rédac’ chef de Trax Magazine, il continue aujourd’hui d’explorer les mutations du son pour Arte, notamment avec sa série Auto-Tune. Il revient avec nous sur son parcours, ses débuts entre disques de jazz et débats en famille, son rapport à l’écriture et aux transformations du métier.
L’interview Tales
C’est quoi tes premiers souvenirs liés à la musique ?
Mon père était prof de musique au collège, donc à la maison, il y avait des instruments
partout. Il avait aussi une énorme collection de disques. Un de mes premiers souvenirs forts,
c’est moi, petit, devant ses vinyles, à lui décrire des images ou des émotions — genre « une
grande ville, la nuit, il vient de pleuvoir » — et lui qui me proposait Chet Baker, Kind of Blue,
Libertango de Piazzolla. Il me faisait une pile, me disait : « Va écouter ça dans ta chambre et
vois ce que ça te fait. » C’est comme ça que j’ai construit une partie de ma culture musicale :
en essayant de mettre des noms sur des sensations.
Et à quel moment tu t’es dit : “la musique fera partie de ma vie, même pro” ?
À l’adolescence. J’écoutais Offspring, des groupes de rock, et je ressentais des trucs
tellement puissants que je me disais : « Ça ne peut pas ne pas faire partie de ma vie. » Et
puis je lisais les chroniques des magazines musicaux ,je découvrais qu’on pouvait être payé
pour donner son avis sur un disque. Je comprendrai plus tard qu’on n’est pas tant payé que
ça (rires) mais à l’époque, ça me fascinait.
Il y a des albums que tu écoutes encore pour retrouver cette époque ?
Oui, bien sûr. Mon père est décédé il y a deux ans, et j’ai récupéré toute sa collection.
Écouter certains disques, c’est me reconnecter à lui. Par exemple, Get Yer Ya-Ya’s Out des
Rolling Stones, Kind of Blue de Miles Davis, plein de disques de jazz… Je revois mon père
me raconter des histoires autour de ces morceaux. Ça reste très présent.
Comment t’as compris que ton truc, c’était pas jouer mais écrire sur la musique ?
J’ai essayé d’être guitariste, j’ai fait le conservatoire, mais j’ai vite vu que ce qui me
passionnait, c’était les discussions autour de la musique, les débats infinis avec les potes ou
en famille. C’est là que je me sentais à ma place : pas dans l’interprétation, mais dans la
transmission, dans le fait d’écrire.
Tu peux retracer les grandes étapes de ton parcours ?
Il y a eu plusieurs chapitres.
D’abord, la découverte musicale très jeune avec mon père. Puis le conservatoire, qui m’a
appris à comprendre la musique d’un point de vue plus structurel.
Ensuite, la fac, où j’ai compris qu’il y avait des filières où on pouvait écrire sur la musique.
J’ai commencé à envoyer des textes, à écrire un peu partout, jusqu’à devenir rédacteur en
chef de Trax.
Là, j’ai développé une vision plus éditoriale, moins centrée sur mes propres papiers. Et
depuis, j’alterne entre presse écrite et documentaires.
C’est qui la première personne ou le premier média qui t’a mis le pied à l’étrier ?
Plus qu’une personne, c’est un magazine. Le premier qui m’a donné ma chance, c’était
Snatch. Il s’est arrêté en 2015, si je dis pas de bêtise. Pour le resituer, c’était une sorte de
version uniquement culture de ce que ferait Society aujourd’hui : des longs récits, de la
place pour les histoires, des formats longs mais centrés sur la culture.
C’était un magazine que je lisais, que j’aimais beaucoup. Et je pensais pas forcément
pouvoir y avoir ma place. Le hasard des rencontres a fait qu’un jour, on m’a proposé
d’essayer d’écrire un petit truc pour eux. Moi, tout stressé, je l’ai écrit super vite pour être
dans les temps, faire le bon élève. Je pense que ce côté bon élève leur a plu. Ils m’ont
confié de plus en plus de choses. Et c’est là que tout a commencé pour moi.
Je leur serai toujours reconnaissant de m’avoir fait confiance à un moment où moi-même, je
n’étais pas sûr d’avoir ma place. C’est d’ailleurs comme ça que j’ai connu Quentin Guériot
(ex DG de Trax)
Cette fameuse couverture de Jul sur Trax, tu peux nous en parler ?
J’étais fraîchement rédacteur en chef. On voulait bousculer la ligne éditoriale, ouvrir à un
public plus jeune. Trax s’enfermait un peu dans un entre-soi de puristes de l’électro, et moi,
ce truc de dire « je vaux mieux que toi parce que j’écoute ça », je déteste.
À la rédac, on écoutait vraiment Jul, on aimait ça. Et Marseille devenait une ville dont on
parlait de plus en plus. Donc ce n’était pas juste un coup de com’. Mais oui, la couv’ a fait
réagir. Certains sont partis, d’autres sont arrivés. J’ai tendance à penser qu’on a perdu les
moins ouverts et gagné les plus curieux.
Le documentaire sur l’autotune pour Arte, c’était quoi l’idée ?
Tout est parti des débats qu’on avait entre amis : est-ce que l’autotune, c’est tricher ? Est-ce
que c’est chanter ? PNL venait de percer en France. Il y avait une esthétique autotune très
forte. On voulait raconter cette vibe robotique et mélancolique, et en même temps répondre
aux critiques.
C’était aussi une manière d’expliquer ce que cet outil a produit en termes de sons,
d’imaginaires, de controverses.
Tu sens un engouement croissant pour les docs musicaux ?
Oui. Les chaînes cherchent à toucher un public plus jeune. Il y a aussi l’effet YouTube :
beaucoup de formats hybrides apparaissent. Et paradoxalement, à côté des formats courts
type TikTok, il y a un vrai désir de formats longs. Le documentaire sur DJ Mehdi, par
exemple, a super bien marché. Ça montre qu’on peut creuser un propos, développer, et que
le public est là.
C’est quoi, pour toi, le grand changement du métier ?
Quand j’ai commencé, le journaliste devait s’effacer. Aujourd’hui, on demande aux
journalistes d’avoir une voix, d’être visibles, présents sur les réseaux. Il y a une vraie logique
de self-branding.
Les journalistes deviennent parfois plus suivis que les médias eux-mêmes. Ça change
l’équilibre. Et techniquement aussi, tout a évolué : les logiciels, la vitesse de production, tout
va plus vite.
Avec 200 000 morceaux qui sortent chaque jour sur Spotify, comment on fait pour ne
pas se sentir submergé quand on est journaliste musical ?
Franchement, on se sent submergé. C’est impossible d’écouter tout ce qui sort. La seule
solution, c’est d’écouter moins, mais mieux.
Et mieux écouter, ça veut dire prendre le temps de comprendre le morceau, son contexte,
les enjeux autour. Pourquoi cette batterie sonne comme ça ? Qu’est-ce que ça dit du genre
musical, de l’époque, du parcours de l’artiste ?
Aujourd’hui, on n’a jamais écouté autant de musique, mais peut-être jamais aussi mal. Tout
devient fond sonore. Un album sort, deux heures plus tard tout le monde crie que c’est
l’album de l’année… puis on passe au suivant. Moi, avec le temps, mon rapport à la
musique est devenu plus lent, plus attentif.
Je reviens beaucoup à l’écoute sur disque. Parce que ça m’oblige à ralentir. Aller le
chercher, le poser, changer la face. Ce temps-là, c’est ce qui permet de vraiment construire
un propos, de faire une critique qui ait du fond.
Tu as pensé un jour à créer ton propre média ?
Non.. Il y a déjà beaucoup de médias. Et j’aime le travail d’équipe. Créer un média, c’est
souvent une aventure très solitaire au début. Je préfère remodeler un média existant. Et
honnêtement, je serais incapable de choisir un nom…
Tu slashes beaucoup entre presse, image, écriture… C’est voulu ?
Je pense que le journalisme est, par nature, un métier multicasquette. Il faut être curieux,
savoir rebondir, raconter une histoire de la meilleure manière possible. Et oui, moi j’aime
multiplier les angles, explorer différents formats.
Une scène que tu rêverais de documenter ?
La scène des sound systems en Jamaïque.
Un artiste à interviewer en long format ?
Bad Bunny, sans hésiter. Il a une empreinte sociétale énorme, et musicalement, c’est un
phénomène.
Et sinon, j’ai eu la chance d’interviewer Ryuichi Sakamoto. C’est l’interview qui m’a le plus
marqué. Un puits de sagesse, d’élégance, d’intelligence. J’aurais adoré pouvoir reparler
avec lui.
Et si tu pouvais téléporter ton bureau où tu veux ?
Tokyo, Lisbonne, mais en vrai, Paris. J’ai beau avoir vécu ailleurs, c’est là que je me sens le
mieux. L’énergie de la ville me stimule