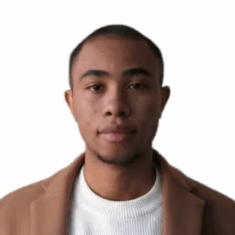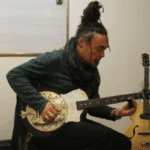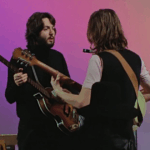Le banjo, avec son timbre métallique distinctif et sa sonorité rythmique inimitable, est un instrument fascinant dont l’histoire traverse les continents et les cultures. Du luth africain aux musiques folk et bluegrass, son évolution est une aventure à part entière. Plongeons dans l’histoire riche et complexe de cet instrument aux multiples influences.
Une origine africaine : le lien avec les luths traditionnels
Si le banjo est aujourd’hui largement associé à la musique folk américaine, ses racines plongent en réalité dans le continent africain. Avant l’essor du banjo moderne, de nombreux instruments à cordes pincées étaient déjà utilisés en Afrique de l’Ouest. Parmi eux, on trouve le ngoni du Mali et l’akonting de la région de la Gambie et du Sénégal, qui partagent plusieurs caractéristiques fondamentales avec le banjo.
Ces instruments se composent d’une caisse de résonance faite d’une calebasse recouverte d’une peau animale, ainsi que d’un manche doté de cordes. Le jeu repose souvent sur des techniques de picking et de percussions sur la caisse, offrant une richesse rythmique impressionnante. L’akonting, en particulier, est un instrument que l’on peut considérer comme un ancêtre direct du banjo. Fabriqué avec des matériaux naturels comme du bois, des peaux de chèvre et des cordes en boyau, il est toujours joué par certaines ethnies comme les Jola en Afrique de l’Ouest.
Lorsque des millions d’Africains ont été réduits en esclavage, ils ont emporté avec eux leur culture musicale, et ont recréé ces instruments dans le Nouveau Monde en utilisant les matériaux disponibles, comme des calebasses ou des barriques en bois pour la caisse de résonance et du parchemin animal pour la peau tendue. Ils servaient principalement dans les cérémonies communautaires, où la musique jouait un rôle fondamental dans la préservation des traditions et l’expression identitaire.
Le banjo dans l’Amérique coloniale
Dès le XVIIe siècle, des références à des instruments ressemblant au banjo apparaissent dans les colonies américaines, notamment dans les plantations du Sud. Des descriptions historiques mentionnent des « banjars » ou « banjers », qui présentent une structure similaire au banjo moderne. Thomas Jefferson, le troisième président des États-Unis, évoque en 1781 un instrument à cordes pincées joué par les populations afro-américaines.
Le banjo était un élément central des réunions musicales dans les plantations, servant à rythmer les chants de travail, les cérémonies religieuses et les danses communautaires. Il était souvent joué en accompagnement des call-and-response songs, un style musical où un soliste chante une phrase immédiatement répétée ou complétée par un chœur. Cette interaction musicale, héritée des traditions africaines, a profondément influencé le développement des musiques afro-américaines.
À mesure que le banjo gagnait en notoriété, il a commencé à se diffuser au-delà des plantations, attirant l’attention des musiciens blancs qui l’ont intégré dans leurs propres répertoires.
Ce phénomène a marqué le début d’une appropriation culturelle qui allait transformer l’instrument et influencer son évolution au cours du XIXe siècle.
L’évolution du banjo au XIXe siècle
Le XIXe siècle marque une période d’expansion et de transformation du banjo.
L’essor du minstrelsy
Dans les années 1830 et 1840, le banjo commence à gagner en popularité auprès des musiciens blancs à travers les spectacles de minstrelsy, un genre de divertissement typique de la culture sudiste esclavagiste. Ces spectacles mettaient en scène des artistes blancs avec un blackface, qui caricaturaient de façon raciste la culture afro-américaine.
Bien que peu glorieux, ce fut l’un des premiers vecteurs de diffusion du banjo auprès du grand public blanc américain. Les “performances” théâtrales et musicales de ces spectacles ont contribué paradoxalement à populariser le banjo tout en occultant son héritage africain.
L’un des premiers musiciens blancs à populariser le banjo fut Joel Walker Sweeney, qui aurait appris l’instrument au contact de musiciens afro-américains. Il est également à l’origine de l’ajout de la cinquième corde, un élément qui deviendra emblématique du banjo moderne. Sweeney et son groupe de minstrel performers ont parcouru les États-Unis et l’Europe, contribuant à faire du banjo un instrument incontournable de la scène musicale de l’époque.
L’industrialisation de l’instrument
Avec la croissance de l’industrie musicale et la demande accrue pour cet instrument, des fabricants commencent à produire des banjos en série dès la fin du XIXe siècle. La fabrication artisanale laisse place à des modèles standardisés, notamment avec l’utilisation d’un cercle en bois et d’une peau tendue comme table d’harmonie. Ce passage à une production industrielle permet au banjo de se démocratiser et d’être accessible à un plus large public.

Des luthiers tels que William Boucher à Baltimore ou encore la société Fairbanks & Cole à Boston commencent à perfectionner la conception du banjo, introduisant des innovations comme l’utilisation de tensionneurs métalliques pour ajuster la peau du tambour. Ces améliorations offrent un meilleur contrôle du son et une plus grande stabilité de l’instrument, facilitant son intégration dans des ensembles plus variés.
Parallèlement, l’introduction du banjo à résonateur, popularisé au début du XXe siècle par des fabricants comme Gibson, permet d’augmenter le volume sonore, rendant l’instrument plus adapté aux performances en groupe et aux orchestres. Cette avancée contribue à l’essor du banjo dans le ragtime, le jazz et plus tard le bluegrass.
L’industrialisation du banjo marque donc une nouvelle ère pour l’instrument. Ce dernier n’est plus seulement un outil de musique populaire, mais devient un instrument de concert à part entière, bénéficiant d’une reconnaissance accrue dans divers styles musicaux. Ce processus façonne profondément son image et son rôle dans la musique américaine et au-delà.
Le banjo dans le folk, le bluegrass et au-delà
Le folk revival et le bluegrass
Le XXe siècle voit le banjo trouver sa place dans plusieurs styles musicaux, notamment le folk et le bluegrass.
Dans les années 1940, le bluegrass, un sous-genre de la country, émerge sous l’impulsion de musiciens comme Bill Monroe et son groupe, les Blue Grass Boys. Mais c’est surtout Earl Scruggs qui révolutionne le jeu du banjo en popularisant le Scruggs-style picking, une technique utilisant trois doigts pour créer un son fluide et rapide, distinct du style clawhammer traditionnel. Grâce à cette approche innovante, le banjo devient un instrument soliste à part entière, capable de rivaliser avec le violon ou la mandoline en termes de virtuosité.
Le mouvement folk revival des années 1950-60, porté par des artistes comme Pete Seeger, The Kingston Trio et Joan Baez, remet le banjo sur le devant de la scène, notamment dans les chansons engagées et populaires. Seeger, en particulier, contribue à élargir la portée de l’instrument en publiant des méthodes d’apprentissage et en l’introduisant dans des contextes variés, du protest song à la musique traditionnelle américaine.
Durant cette période, le banjo devient un symbole de contestation et d’authenticité, utilisé dans des morceaux dénonçant l’injustice sociale et les inégalités raciales. Des festivals comme le Newport Folk Festival participent à sa popularisation, permettant à de nouvelles générations de musiciens de s’approprier l’instrument.
L’essor du bluegrass et du folk revival assoit ainsi la place du banjo dans la musique américaine moderne, en le transformant en un pilier incontournable des scènes folk, country et acoustique.
Le banjo dans d’autres genres musicaux
Si le bluegrass et le folk restent les terrains de jeu de prédilection du banjo, on le retrouve aussi dans d’autres styles inattendus :
Dans le rock et pop : The Eagles, Led Zeppelin ou encore The Avett Brothers intègrent parfois le banjo dans leurs compositions, donnant à leurs morceaux une couleur folk authentique. Un titre comme Gallows Pole de Led Zeppelin illustre bien cette fusion entre rock et influences traditionnelles.
Dans le Jazz : Chez des artistes comme Johnny St. Cyr et Eddie Peabody, le banjo était préféré à la guitare pour sa puissance sonore et sa clarté dans les ensembles de jazz de la Nouvelle-Orléans. Son timbre percussif permettait de soutenir le rythme tout en offrant une alternative mélodique dynamique.
Dans la musique celtique : Adopté dans les musiques traditionnelles irlandaises et écossaises, le tenor banjo est aujourd’hui un incontournable du genre. Il est souvent joué avec un médiator et accordé comme un violon, permettant aux musiciens d’exécuter des reels et des jigs à une vitesse impressionnante.
Dans la musique électronique et expérimentale : Plus récemment, des artistes de musique électronique et expérimentale ont commencé à intégrer le banjo dans leurs compositions. Des groupes comme Béla Fleck and the Flecktones fusionnent le banjo avec des éléments de jazz fusion, de funk et même de musique électronique, démontrant la polyvalence insoupçonnée de l’instrument.
Dans le blues : Bien que le blues soit plus souvent associé à la guitare, le banjo a joué un rôle essentiel dans ses débuts. Des artistes comme Papa Charlie Jackson enregistraient du blues au banjo dans les années 1920, avant que la guitare ne devienne dominante.
Aujourd’hui, des artistes contemporains comme Taylor Swift, Mumford & Sons ou encore Sufjan Stevens revisitent le son du banjo dans des contextes modernes, prouvant que cet instrument ancestral continue d’évoluer et de surprendre dans une multitude de styles.
En résumé
- Le banjo trouve ses racines dans les instruments à cordes africains comme le ngoni ou l’akonting.
- Introduit en Amérique par les populations réduites en esclavage, il devient central dans les plantations pour accompagner chants et danses.
- Au XIXe siècle, il est popularisé via le minstrelsy et transformé par des musiciens comme Joel Walker Sweeney.
- L’industrialisation du banjo permet sa diffusion à grande échelle et son intégration dans des contextes de concert.
- Il s’impose au XXe siècle grâce au bluegrass (Earl Scruggs) et au folk revival (Pete Seeger).
- Aujourd’hui, il s’invite dans une diversité de genres : rock, jazz, musique celtique, blues, voire musique électronique.
- Symbole de métissage culturel, le banjo reste un instrument en constante évolution et réinvention.
Sources
- Laurent Dubois, The Banjo: America’s African Instrument, Harvard University Press, 2016.
- Robert Winans, “The Banjo in the United States: A Brief History,” The Journal of American Folklore, 1976.
- Dena J. Epstein, Sinful Tunes and Spirituals: Black Folk Music to the Civil War, University of Illinois Press, 1977.
- Smithsonian Folkways – Archives musicales et ressources pédagogiques.